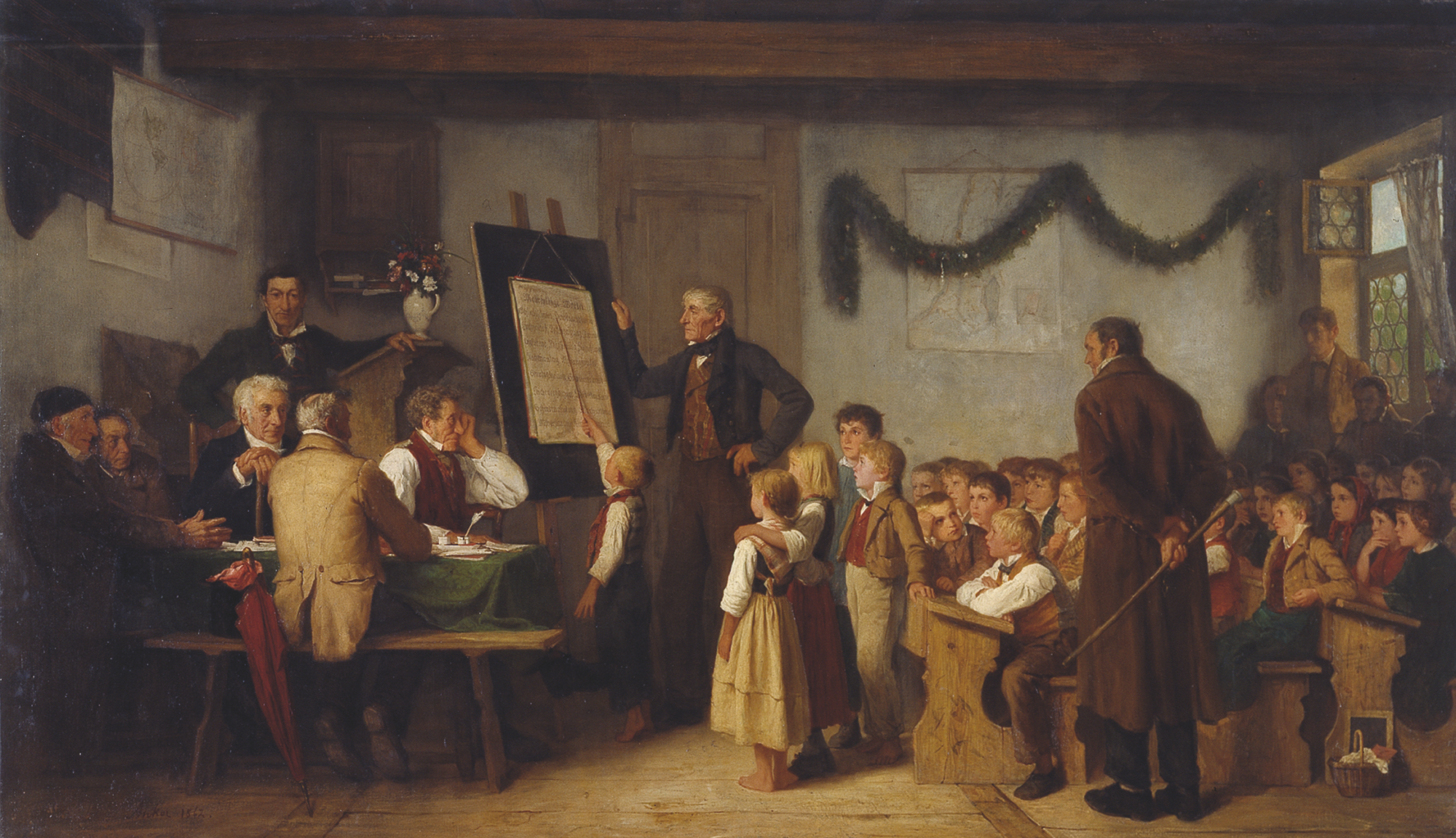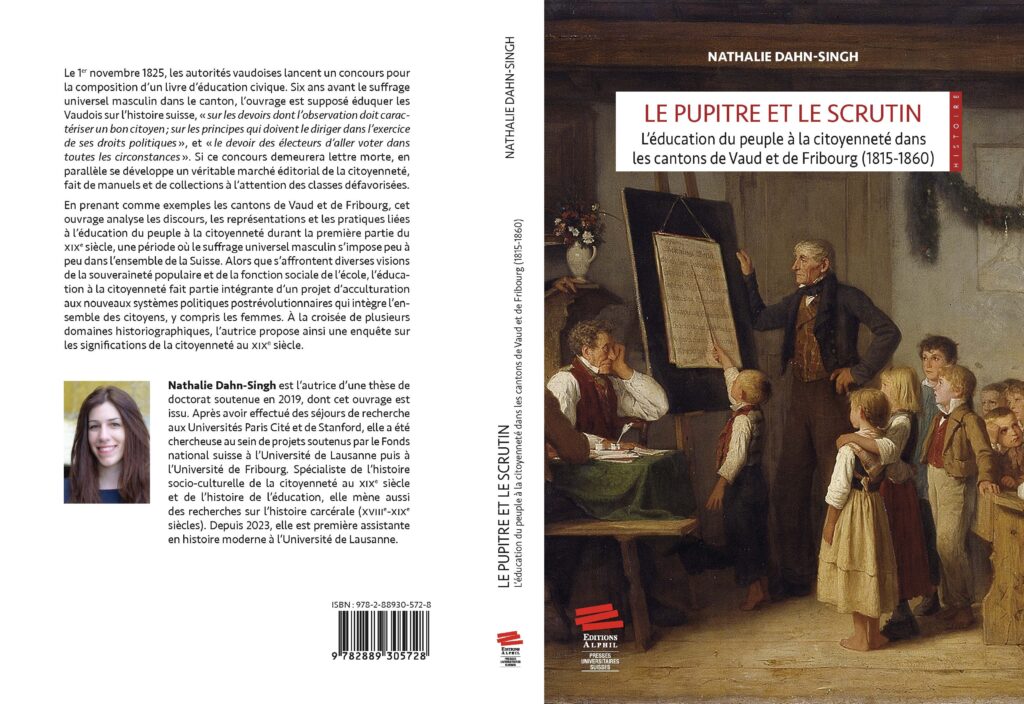Guerres en images, images de guerres est un livre en couleurs de 266 pages, comprenant 213 illustrations et 3 cartes. Il est le fruit d’un colloque international, s’étant tenu peu de temps avant que la crise sanitaire du Covid ne vienne bouleverser le dialogue universitaire, a réuni des chercheurs issus d’un large éventail de pays et de disciplines, afin de débattre des représentations de la guerre dans les manuels scolaires et de la manière dont elles ont contribué à façonner différents récits culturels à l’échelle de l’Europe. Les interventions ont permis de décrypter les caractéristiques de discours politiques en images, que les enfants ont été encouragés à intégrer. Elles ont aussi soulevé les questions inhérentes à la refonte d’une histoire scolaire commune avec pour finalité de forger une véritable identité citoyenne européenne.
L’illustration des conflits dans les manuels d’Histoire et l’iconographie pédagogique en Europe.
Comment un évènement historique, ici un évènement de guerre, peut-il se métamorphoser en récit illustré dans un manuel scolaire ? Au moment où la guerre réapparait sur le continent européen, la thématique développée dans cet ouvrage, prend une tournure toute particulière et vient s’ancrer dans une actualité brûlante…D’aucun ne peut être que rempli d’effroi aujourd’hui devant ce qui reste de certaines villes, rayées de la carte, vidées de ses habitants… Les images véhiculées par les médias montrent des espaces désertés, marqués par les stigmates de l’enfer des bombardements. L’image ici témoigne de la violence des combats, d’une humanité en déshérence, d’un chaos dominé par la terreur du feu : aujourd’hui comme hier l’empreinte de la guerre en image force l’imagination et l’effroi.
Fruit d’un colloque international qui s’est tenu peu de temps avant que la crise sanitaire du Covid ne vienne bouleverser le dialogue universitaire – le colloque International de Saint-Dié-des-Vosges qui s’est tenu les 25, 26 et 27 juin 2019 – cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail pluridisciplinaire. Il a réuni des chercheurs issus d’un large éventail de pays et de disciplines, afin de débattre des représentations de la guerre dans les manuels scolaires et de la manière dont elles ont contribué à façonner différents récits culturels à l’échelle de l’Europe. Les contributions permettent de décrypter les caractéristiques de discours politiques en images que les enfants ont été encouragés à intégrer tout au long de leur cursus. Elles soulèvent les questions inhérentes à la refonte d’une histoire scolaire commune avec pour finalité de forger une véritable identité citoyenne européenne.
Coordonné par deux chercheurs de l’Université de Lorraine, Cédric Prévot, professeur des écoles, doctorant en épistémologie et Denis Morin, maitre de conférences émérite, directeur de recherche, tous deux rattachés au laboratoire Histoires et Cultures de l’Antiquité et du Moyen-Âge, cet ouvrage pose les bases de futures recherches sur le rôle de l’image dans les manuels scolaires et plus généralement sur la didactique de l’Histoire.
Lien vers la publication