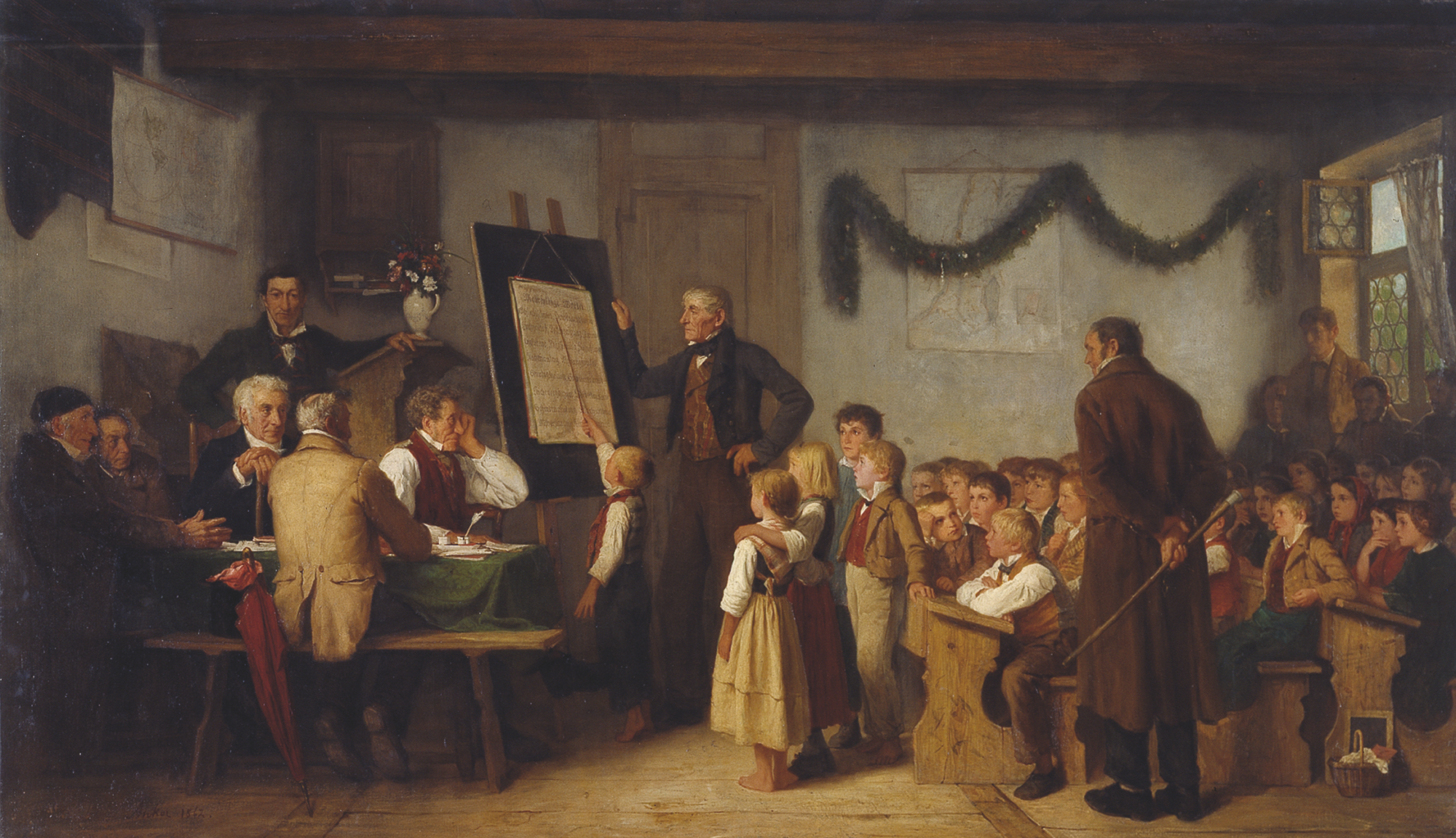Nouvelle parution : Socialismes et éducation au XXe siècle, Guy Dreux, Gilles Candar & Christian Laval, Le Bord de l’eau
Au tournant du XIXe siècle, les différentes gauches, presque toutes converties au réformisme social, ont trouvé dans l’expansion scolaire une puissante raison d’être. Mais les chocs qui secouent ce progressisme au cours du XXe siècle bouleversent les représentations de l’école républicaine : d’un facteur providentiel de justice sociale, celle-ci s’est mue en un terrain de conflit sur lequel les idéologies égalitariste et néolibérale entrent en collision. Un vent critique souffle sur le milieu enseignant, politique et universitaire face au constat de l’explosion des effectifs à tous les niveaux de l’enseignement, de l’inefficacité de certaines pédagogies et de « école unique » dans la lutte contre la reproduction sociale…
Au sein même du projet socialiste, la montée d’une vision utilitariste de l’école vient questionner la finalité du système éducatif français. De plus en plus considérée comme une machine à produire des compétences et des travailleurs compétitifs, l’École est progressivement mise au service de la modernisation du pays et, plus tard, de l’Europe.
Tout au long du XXe siècle, les gauches, les syndicats, les enseignants et les intellectuels prennent acte et construisent un nouveau modèle de prospérité et d’émancipation par et pour l’enseignement. Cet ouvrage explore les temps forts qui ont jalonné ce siècle de la démocratisation du système scolaire en France ainsi que les figures qui l’ont incarné.